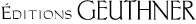Le droit en monde syriaque
Auteur : BERTI Vittorio, DEBIÉ M.
Prix (TTC) : 45.00 €
Parution : 2023
/ En savoir plus... /
Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,
celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-
chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).
Le thème du droit dans les contextes de présence syriaque, tant sur le plan ethnique que du point de vue de la diffusion des Églises, est essentiel pour comprendre comment les communautés étaient organisées à un certain moment de l’histoire, quels modèles comportementaux et sociétaux étaient ou non admissibles et quelle a été l’évolution dans l’espace et dans le temps des textes et des pratiques.
Héritières des cultures juridiques du Proche-Orient ancien et liées à celles des empires dans lesquels elles se développèrent, la réflexion et la pratique juridiques syriaques, porteuses de leur propre mode autochtone de régulation des relations mercantiles et patrimoniales, ont été fortement enrichies par l’influence des traditions juridiques d’Israël, par la présence en Syrie occidentale de la culture et des institutions juridiques romano-byzantines, par la confrontation en monde iranien avec celle des Perses sassanides, et enfin par le nouveau monde éthique et juridique apparu avec l’avènement de l’Islam à partir du viie siècle dans tout le Proche et Moyen-Orient.
L’expansion des communautés et des Églises de tradition syriaque s’est accompagnée d’une caravane de lois et de traditions jurisprudentielles recueillies, préservées, transmises et constamment intégrées par les lettrés syriaques dans un paysage ethnique et culturel asiatique encore plus vaste. Celui-ci a contribué à façonner un certain « relativisme » vis à vis des systèmes juridiques et des coutumes avec lesquelles les chrétiens syriaques ont appris à composer. De là sont nées une créativité et une liberté dans l’élaboration de solutions pour les différents cas de vie, sous le regard des évêques et des dirigeants communautaires.
Droit des Églises, le droit en syriaque est envisagé dans ce volume dans le contexte des droits impériaux dans lesquels il s’est développé et par rapport auxquels il s’est défini. Droit civil et droit ecclésiastique doivent être ainsi appréhendés en interaction et en situation multilingue, le droit des Églises syriaques entrant en dialogue avec celui des autres communautés religieuses et des États.
Ce volume rassemble une série de contributions visant à présenter les sources du droit en monde syriaque afin de les rendre accessibles aux non-spécialistes. Il a pour but également de faire un point sur les études historiques concernant les contextes dans lesquels textes et corpus sont apparus et l’impact qu’ils ont eu. Il s’intéresse aussi aux pratiques du droit et aux conditions d’exercice de la justice, ouvrant ainsi des fenêtres vers des études d’histoire sociale, d’histoire culturelle et d’études de genre en permettant un accès à des catégories sociales peu représentées dans d’autres types de textes, comme les femmes, les enfants, les esclaves.
Les anciens systèmes notariaux présents dans les contextes araméophones, la manière dont les sources canoniques se rapportent aux juifs et au judaïsme, l’impact de la production canonique alexandrine et des textes synodaux antiochiens dans le contexte syriaque, la réflexion théologique sur le droit séculier, la tradition canonique syro-occidentale, de Sévère d’Antioche aux synodes du ixe siècle, jusqu’à la relation entre le droit canonique et le droit islamique sont autant de sujets étudiés.
ISBN 10 : 2705341152
ISBN 13 : 9782705341152
Collection : Études syriaques
Pages : 494
Format (mm) : 160x240
Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes
Mots-clés : syriaque, droit, étude, histoire, culture
Manuscripta Syriaca
Des sources de première mainAuteur : BRIQUEL CHATONNET F., DEBIÉ M.
Prix (TTC) : 50.00 €
Parution : 2015
/ En savoir plus... /
Longtemps envisagé essentiellement comme support et transmetteur de textes, le manuscrit, dans le domaine des études syriaques, a fait récemment l’objet d’une attention renouvelée. C’est désormais aussi le livre lui-même dans sa matérialité qui est étudié, comme objet de la culture syriaque et témoignage sur la vie des hommes qui les ont copiés, décorés, lus et conservés.
Ce volume s’inscrit dans ce courant de recherches. Consacré aux manuscrits syriaques, il est issu d’une session sur le sujet organisée dans le cadre du XIe Symposium Syriacum à La Valette (Malte) en 2012. Il envisage les manuscrits aussi bien du point de vue des textes qui y sont préservés que du livre en lui-même.
Quatre approches principales ont été retenues : la présentation de projets en cours de numérisation, de catalogage et de description des manuscrits dans diverses collections ; des études consacrées au manuscrit comme objet concret, à ses matériaux et à sa fabrication ; l’analyse du travail du copiste de l’écriture et la décoration aux informations fournies par les colophons ; et enfin des travaux d’identification et d’édition des textes manuscrits.
Cette publication se veut un point d’étape, dans l’attente que les données nouvelles sur les manuscrits issues des catalogues désormais plus détaillés et de la base de données e-ktobe, permettent d’écrire une véritable histoire du livre syriaque.
ISBN 10 : 2705339364
ISBN 13 : 9782705339364
Collection : Cahiers d'études syriaques
Pages : 450
Format (mm) : 160x240
Discipline : Histoire-Géographie
Mots-clés :
Sur les pas des Araméens chrétiens
Mélanges offerts à Alain DesreumauxAuteur : BRIQUEL CHATONNET F., DEBIÉ M.
Prix (TTC) : 55.00 €
Parution : 2010
/ En savoir plus... /
Ce volume, qui inaugure une nouvelle collection publiée par la Société d’études syriaques, est un florilège d’articles offerts par des amis, collègues et étudiants à Alain Desreumaux à l’occasion de son départ à la retraite, pour le remercier de sa contribution, de son enthousiasme et de son engagement dans la défense et l’illustration des cultures syriaque et christo-palestinienne.
Les différentes contributions qui composent le volume sont regroupées selon six axes :
Constellations apocryphes
- Jean-Claude Haelewyck – L’apport des Instituta de Junillus Africanus à la question du canon scripturaire de la tradition syriaque (Ancien Testament)
- David Taylor – The Patriarch and the Pseudepigrapha : Extra-biblical traditions in the writings of Kyriakos of Tagrit (793-817)
- Muriel Debié – Les apocryphes et l’histoire
- Baby Varghese – The Acts of Judas Thomas and Early Syriac Liturgy
- Elena Mescherskaja – « L’Adoration des mages » dans l’apocryphe syriaque Histoire de la Vierge Marie
- Charles Naffah – L'apocalypse de la Vierge dans la tradition syro-occidentale médiévale
- Claire Fauchon – L’apôtre au banquet : L’hospitalité dans les apocryphes apostoliques syriaques
- Jacques-Noël Pérès – Édesse éthiopienne
- Dominique Couson – L'image d'Edesse sur les murs des monastères de l'ex-Yougoslavie
Ce que disent les manuscrits
- Sebastian Brock – Les signatures en chiffres arithmétiques dans les manuscrits syriaques de la British Library
- Pier Giorgio Borbone – L’itinéraire du « Codex de Rabbula » selon ses notes marginales
- André Binggeli – Un ancien calendrier melkite de Jérusalem (Sinai syr. M52N)
- Paul Géhin – Un feuillet oublié de Martyrius/Sahdona à Milan (Ambr. A 296 inf., f. 87 = Chabot 51)
- Gregory Kessel – Sinai syr. 24 as an Important Witness to the Reception History of Some Syriac Ascetic Texts
- Bernard Outtier – Une exhortation d’Ephrem le Syrien à des moines en géorgien ? (CPG 2152 -2945 - 4135.4 - 4145.16)
- Laurent Capron – Le fragment araméen christo-palestinien de la Vie d’Abraham de Qidun de la Taylor-Schechter Collection (ms. T.S. 12746) : nouvelles lectures
- Robert Hawley – Three fragments of Antyllus
... les pierres et les objets
- Jean-Pierre Sodini & Jean-Luc Biscop – L’accès Nord au domaine de Syméon le stylite : le village de Shih (Shih ed Deir-Shader, Bardakhan)
- Françoise Briquel Chatonnet – L’inscription de Bamuqqa et la question du bilinguisme gréco-syriaque dans le massif calcaire de Syrie du Nord
- Joseph Moukarzel, Jean-Baptiste Yon, Youssef Dergham – Le site de Hras
- Narmin ali amin – Notre Dame des Semences à Fishabur et ses inscriptions syriaques
- Amir Harrak – Un médaillon chrétien en bronze de Mossoul
- Marie-Hélène Rutschowscaya – Ce que racontent les murs d’un ermitage copte…
Littérature et pratiques
- François Cassingena – Requiem pour Anazit. Éphrem de Nisibe Carmina Nisibena X, traduction et notes
- Christelle & Florence Jullien – Du Ḥnana ou la bénédiction contestée
- Jacob Thekeparampil – Morning and Evening (Ramšo and Ṣapro) as ‘Deacons and Schoolmasters’ in the West Syriac Liturgical Tradition
Chrétiens et manichéens
- Paul-Hubert Poirier – Pour une étude des citations bibliques contenues dans le Contra Manichaeos de Titus de Bostra
- Stanley Jones – Some Things Mani Learned from Jains
- Mère Philothée du Sinaï – Du monde syriaque au monde asiatique
Hier et aujourd’hui
- Florence Hellot Bellier – Souffle de réformes sur trois Églises en Perse dans la seconde moitié du XIXe siècle
- Harald Suermann – Arabische Christen in Israel und palästinensische Christen
ISBN 10 : 2705338373
ISBN 13 : 9782705338374
Collection : Cahiers d'études syriaques
Pages : 448
Format (mm) : 160x240
Poids : 780g
Illustrations : 34 photos couleurs
Discipline : Religions-Mythologies
Mots-clés : apocryphes, calendrier, codex, martyrs, architecture, fragments, inscriptions, bible, christianisme, réforme, Perse, Iran
Études syriaques 6
L'historiographie syriaquePrix (TTC) : 35.00 €
Parution : 2009
/ En savoir plus... /
Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).
L’historiographie syriaque Des textes historiques très nombreux ont été produits de manière continue en syriaque du vie au xive siècle. L’écriture de l’histoire naît dans cette langue avec les convulsions christologiques qui entraînent le développement de l’Église syro-orientale dans l’empire sassanide et la séparation progressive de l’Église syro-orthodoxe dans l’empire romain. C’est pour raconter l’histoire de leurs communautés que les Églises de langue syriaque ont produit histoires ecclésiastiques et chroniques. C’est aussi pour expliquer les événements dramatiques que sont famines, épidémies, catastrophes naturelles, victoires des peuples ennemis non chrétiens (sassanides, arabo-musulmans, mongols), mais aussi la cohabitation difficile avec les frères ennemis des autres confessions chrétiennes (y compris les Francs à l’époque des Croisades), que s’élabore une théologie de l’histoire à l’œuvre dans ces textes. L’historiographie est sans doute le seul champ littéraire où co-existent deux traditions d’écriture différentes correspondant à des histoires différentes des communautés, dans l’empire romain d’un côté, dans le royaume sassanide de l’autre, qui subsistèrent après l’unification politique réalisée par les conquêtes arabo-musulmanes : l’une syro-occidentale puisant dans la Chronique d’Eusèbe et les histoires ecclésiastiques de ses successeurs ses modèles ainsi que sa matière, l’autre syro-orientale, fondée sur des biographies, à la manière de la tradition historiographique des écoles philosophiques grecques. Quand l’usage de l’arabe commença à se généraliser dans les cercles cultivés de ces Églises, furent produits des textes bilingues ou des histoires en arabe, qui, comme les textes syriaques eux-mêmes, empruntèrent du matériel historique à des sources musulmanes, aujourd’hui partiellement ou à peu près complètement disparues.
Ce volume s’adresse aussi bien aux byzantinistes qu’aux islamisants et plus largement à tous les spécialistes d’historiographie, la tradition syriaque représentant une branche vive de l’historiographie tardo-antique et médiévale. Il est destiné aussi à tous ceux qui s’intéressent à la manière dont les communautés de langue syriaque ont écrit leur histoire et constitué leur identité, entre hellénisme et islam, en réponse aux troubles des temps.
ISBN 10 : 2705338217
ISBN 13 : 9782705338213
Collection : Études syriaques
Pages : 220
Format (mm) : 160x240
Poids : 350g
Discipline : Religions-Mythologies
Mots-clés : histoire, textes, christianisme, théologie, chronique
Études syriaques 5
L'Ancien testament en syriaqueAuteur : Collectif, BRIQUEL CHATONNET F., DEBIÉ M., DESREUMAUX A.
Prix (TTC) : 40.00 €
Parution : 2008
/ En savoir plus... /
Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).
L’Ancien Testament en syriaque Pourquoi L’Ancien Testament en syriaque et non L’Ancien Testament syriaque ? Tout simplement parce qu’il existe plusieurs versions syriaques de l’Ancien Testament. La version la plus connue est sans conteste la Peshitta ; c’est la version commune aux différentes Églises syriaques, celle qui nourrit la liturgie et la prière quotidienne. Mais elle représente aussi un témoignage d’importance capitale pour l’histoire du texte vétéro-testamentaire car, avec la traduction grecque dite de la Septante, elle est, avant la Vulgate au IVe siècle de notre ère, la seule version ancienne de l’Ancien Testament faite directement sur le texte hébreu. Ses rapports avec les targums sont complexes, mais moins étroits qu’on a pu le penser à une époque. Elle possède aussi de nombreux points de contact avec la Septante ; l’on verra que ceux-ci sont apparus au cours d’une genèse complexe, et continuée durant plusieurs siècles. C’est naturellement une étude attentive des manuscrits qui a permis d’arriver à ces conclusions, et ce volume fait également le point sur la classification et la valeur des différents témoins de la Peshitta et les perspectives qu’offre désormais l’étude des Pères syriaques.
Au début du VIIe siècle, naquit une autre version syriaque de l’Ancien Testament, celle-là traduisant, et cela servilement, la Septante : il s’agit de la Syro-hexaplaire, ainsi nommée parce qu’elle conservait, mieux qu’aucun témoin grec, les signes critiques qu’avait utilisés Origène dans l’établissement de ses Hexaples (la première synopse biblique, pour ainsi dire). Elle connut un grand succès, à la différence d’une autre version, encore aujourd’hui méconnue, celle de Jacques d’Édesse.Le panorama n’aurait pas été complet sans une mention des versions de la Bible susceptibles de dépendre des textes syriaques : il s’agit des versions arménienne, géorgienne et arabes. Ce volume collectif, qui fait le point sur la recherche actuelle, s’adresse non seulement aux syriacisants, mais également à tous ceux que l’histoire et la « fabrication » du texte de l’Ancien Testament intéressent.
ISBN 10 : 2705338144
ISBN 13 : 9782705338145
Collection : Études syriaques
Pages : 250
Format (mm) : 160x240
Poids : 400g
Discipline : Religions-Mythologies
Mots-clés : christiaisme, texte, bible, évangiles, vulgate, septante
Études syriaques 2
Les apocryphes syriaquesAuteur : Collectif, JULLIEN Christelle, DEBIÉ M., DESREUMAUX Alain, JULLIEN Florence
Prix (TTC) : 40.00 €
Parution : 2005
/ En savoir plus... /
Cette série est destinée à regrouper des études thématiques présentant différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).
Ce nouvel ouvrage de la série est consacré aux apocryphes syriaques et en souligne les richesses thématiques : Jésus et sa parenté, épopées d’apôtres partis évangéliser le monde connu, histoires de disciples fondateurs de communautés en Orient - dont les chrétiens font encore mémoire aujourd’hui - interprétations et exégèses bibliques, récits circulant sous un nom célèbre, apocalypses, littérature juridique… Souvent traduits du grec, mais aussi produits directement en syriaque, ces textes ont été transmis dans d’autres aires culturelles, en particulier en arménien, en géorgien et en arabe, où ils ont formé le socle des traditions relatives aux origines chrétiennes.
Ce recueil offre un panorama sur les divers domaines que couvrent les apocryphes syriaques et indique quelques perspectives ouvertes par un corpus très varié. Les chapitres constituent autant d’introductions, par des spécialistes de ces questions, aux différents genres présentés. Ils permettront peut-être aux lecteurs de découvrir l’intérêt de ces textes souvent négligés.
Ce livre collectif est destiné à tous ceux qui s’intéressent aux littératures orientales anciennes et bibliques, aux gestes d’apôtres, aux sciences religieuses de l’Antiquité chrétienne et, d’une manière générale, aux traditions des chrétiens d’Orient.
ISBN 10 : 2705337717
ISBN 13 : 9782705337711
Collection : Études syriaques
Pages : 234
Format (mm) : 160x240
Poids : 370g
Discipline : Religions-Mythologies
Mots-clés : christianisme, texte, bible, évangiles, apocalypse
Études syriaques 1
Les inscriptions syriaquesAuteur : Collectif, BRIQUEL CHATONNET F., DEBIÉ M., DESREUMAUX A.
Prix (TTC) : 40.00 €
Parution : 2004
/ En savoir plus... /
Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).
Les inscriptions syriaques Ce volume collectif est consacré aux inscriptions syriaques, c’est-à-dire en araméen chrétien, des plus anciennes au 5e siècle de notre ère aux plus récentes produites encore de nos jours. Il offre ainsi un panorama sur les inscriptions syriaques de Syrie, de Turquie (syro-orthodoxes du Tur Abdin et syro-orientales du Hakkari), du Liban, du couvent Notre-Dame des Syriens en Égypte, d’Irak, d’Iran (région du lac d’Ourmia), d’Asie centrale (cimetières chrétiens de l’époque mongole), de Chine (de la stèle de Xian aux inscriptions de l’époque mongole) et du Kérala, au Sud de l’Inde. Il s’inscrit dans la préparation du Recueil des Inscriptions Syriaques (RIS) qui sera publié par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Chaque contribution, due au chercheur qui a la charge de publier le corpus correspondant, présente les particularités du groupe des inscriptions concernées, son contexte historique, culturel et ecclésial, et esquisse une typologie. Toutes soulignent l’apport de ces inscriptions à l’étude de l’histoire, de la langue, de la culture de chaque région et des différentes Églises et communautés.
Ce volume de synthèse s’adresse donc non seulement aux syriacisants mais aussi aux historiens étudiant les régions où des communautés syriaques ont fleuri et à toute personne qui s’intéresse à l’histoire de ces communautés.
ISBN 10 : 2705337598
ISBN 13 : 9782705337599
Collection : Études syriaques
Pages : 172
Format (mm) : 160x240
Poids : 300g
Illustrations : 8 pl.
Discipline : Religions-Mythologies
Mots-clés : épigraphie, christianisme, Syrie, Turquie, Tur Abdin, Inde